NLS
Congrès NLS 2026
Varité : Les variations de la vérité en psychanalyse
Les 27 et 28 juin 2026
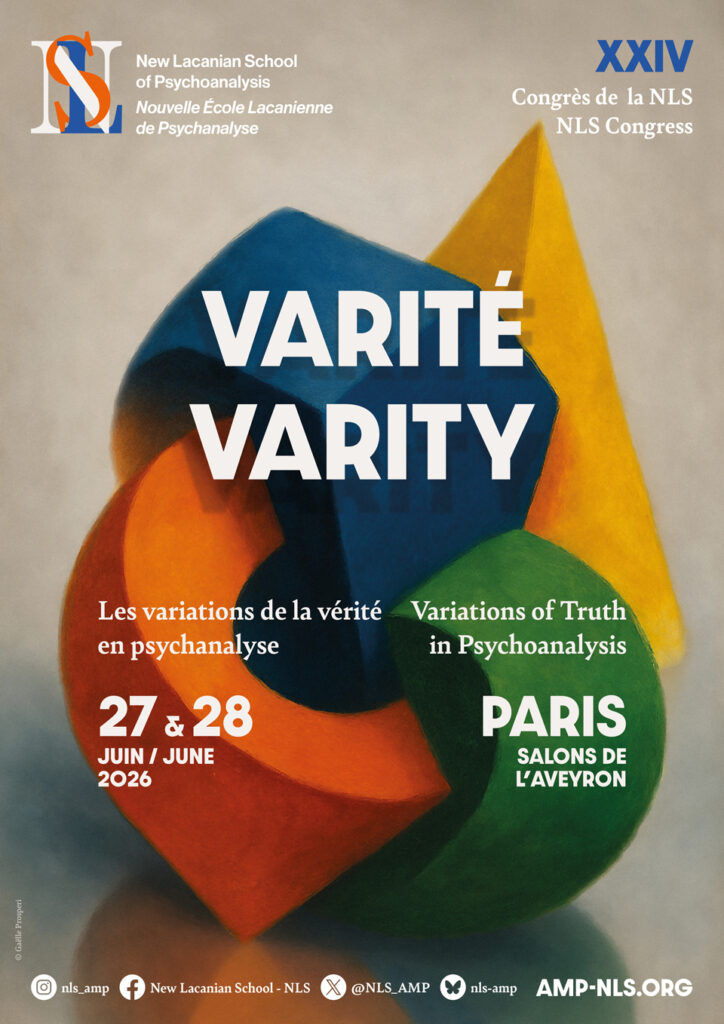
VARITÉ
Les variations de la vérité en psychanalyse
« Je dis toujours la vérité : pas toute,
parce que toute la dire, on n’y arrive
pas. La dire toute, c’est impossible,
matériellement : les mots y manquent.
C’est même par cet impossible que la
vérité tient au réel ».
JACQUES LACAN, Télévision
Le XXIVe Congrès de la NLS se propose d’interroger les variations de la vérité
en psychanalyse. Lacan a condensé dans le néologisme varité 1 les variations de
la vérité qui se produisent dans une analyse au gré des révélations successives.
Il énonce qu’il faudrait s’ouvrir à la dimension de la vérité comme variable et
ajoute que ce que l’analysant dit, ce n’est pas la vérité mais la vari(é)té du
sinthome. Tout au long de son enseignement, Lacan n’a jamais abandonné la
référence à la vérité, qu’il l’ait d’abord abordée comme La vérité ou, plus tard,
comme vérité plurielle, variable et menteuse. Toutefois, une constante
demeure : l’articulation de la vérité ou des effets de vérité avec la structure du
langage et de la parole, voire du « bouillon de langage 2 ».
Vérité , exactitude et révélation
Au départ, Lacan met en valeur une autre dimension de la parole que celle de
l’expression et de la médiation : la révélation. La révélation se rapporte au
dévoilement d’une vérité supposée cachée, voilée et coïncide avec l’instant de
voir. Ainsi la vérité va de dévoilement en dérobade ou échappée, tandis que
l’analyse se définit comme une série de révélations particulières à chaque sujet.
Dans son texte fondateur, « Fonction et champ de la parole et du langage en
psychanalyse 3 », Lacan oppose la parole pleine à la parole vide ; la parole
pleine étant celle où se réalise la vérité du sujet. Dans cette perspective, la vérité
de la révélation concerne la vérité dans la parole. « [P]ar là nous nous heurtons
à la réalité de ce qui n’est ni vrai, ni faux 4 ». La réalité se distingue ici de la
référence à l’exactitude et ne renvoie à aucune conformité à une réalité
objective. La vérité d’une parole ne se fonde pas dans l’adéquation du mot à
la chose. Freud, lui-même, au bout de longues recherches, avait fini par
renoncer en la croyance à la réalité objective des traumatismes qui, dans
l’inconscient, ne se distingue pas « de la fiction investie d’affect 5 ». Ce que
Jacques-Alain Miller formulera comme suit : Dans l’analyse, il ne s’agit « pas
de dire ce qui est », mais « il s’agit de faire vérité de ce qui a été. Et il y a ce qui
a manqué à faire vérité : les traumatismes, ce qui a fait trou […] Il s’agit de
faire venir le discours à ce qui n’a pas pu y prendre rang 6 ».
Mais, surtout, Lacan va situer le nouveau de la découverte freudienne au regard
de ce qui fait irruption dans le discours du sujet qui, lui, « se développe
normalement […] dans l’ordre de l’erreur, de la méconnaissance, voire de la
dénégation 7 ». La vérité surgit de la méprise, du lapsus, de l’acte manqué, de
ce qui achoppe et qui « [révèle] une vérité de derrière », un autre sens. Elle
émerge sous le mode du trébuchement qui rompt le cours de la narration du
sujet et le dépasse. « La vérité rattrape l’erreur au collet dans la méprise 8 ». Ce
qui signifie que le sujet ne sait pas ce qu’il dit, il en dit toujours plus que ce
qu’il ne veut en dire, toujours plus que ce qu’il ne sait en dire.
Lire la suite sur le site de la NLS